Accueil > Mots-clés > sida, un glossaire E > essai thérapeutique
essai thérapeutique
Méthode d’étude d’un nouveau traitement par comparaison avec un traitement classique de référence ou par comparaison avec un placebo (ce dernier type est souvent remis en cause pour des raisons éthiques). Les études chez l’humain sont divisées en quatre phases :
– Phase I : étude de tolérance biologique et clinique, de la toxicité, à différentes doses.
– Phase II : étude d’efficacité thérapeutique et recherche des doses optimales.
– Phase III : étude qui regroupe souvent à plusieurs essais comparatifs pour apprécier l’effet thérapeutique et les effets indésirables à moyen terme. Cette phase débouche éventuellement sur une autorisation de mise sur le marché (AMM).
– Phase IV ou post-AMM : étude permettant d’affiner les connaissances sur un médicament, de mieux préciser les modalités de son utilisation à plus long terme, de recueillir le plus d’informations possible sur la tolérance du produit, l’apparition d’une toxicité ou d’effets indésirables non identifiés préalablement. C’est la phase dite de pharmacovigilance, elle correspond aux conditions habituelles de prescription.
Articles
-
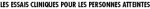 Prises alimentaires, autres médicaments
Prises alimentaires, autres médicaments
16 août 1997
Quelles questions dois-je me poser ?
-
 des études post AMM pour une meilleure qualité de vie
des études post AMM pour une meilleure qualité de vie
29 juillet 2002
Les médicaments anti-VIH que nous prenons quotidiennement sont arrivés il y a longtemps sur le marché : 1987 pour l’AZT, 1996 pour les inhibiteurs de protéase. Les laboratoires ont effectué toutes les études nécessaires à l’obtention de la précieuse AMM
-
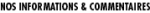 Et toujours
Et toujours
29 janvier 2004
2003 aura été une année riche entre l’ANRS et les associations de lutte contre le sida. En regardant l’état d’avancement des protocoles financés par l’Agence on peut se demander si cette relation se justifie toujours.
-
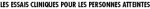 Phase I : le produit est-il sûr ?
Phase I : le produit est-il sûr ?
16 août 1997
Un essai de phase I correspond à la première utilisation d’un nouveau médicament chez des êtres humains.
-
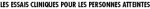 Essai mené sous l’égide de l’ANRS
Essai mené sous l’égide de l’ANRS
16 août 1997
Une idée d’essai germe dans l’esprit d’unE médecin-chercheurSE. Il/elle en parle avec l’équipe avec laquelle il/elle a déjà mené des essais. Ensemble ils/elles présentent un projet à une cellule scientifique de l’ANRS à la suite d’un appel d’offre. Cette cellule étudie l’ensemble des projets, en retient certains, rejettent ceux qui lui semblent sans intérêt. L’ensemble des essais cliniques retenus sont soumis à l’Action Coordonnée n°5 (AC5) qui en discute les modalités pratiques, l’intérêt (…)
-
 Vous avez dit mysogyne ?
Vous avez dit mysogyne ?
Le protocole de l’essai Véga sur le New Fill® pour les personnes lipoatrophiées devait compter cinquante personnes. A la date du 20 octobre, seuls 35 patients avaient été inclus. Sur ces 35 personnes, 34 hommes et une femme (militante d’Act Up). Sur la liste des patients à recruter, ne figurent que des hommes.
-
 Act Up-Paris exige la mise en place d’essais de phase IV
Act Up-Paris exige la mise en place d’essais de phase IV
La journée sur la pharmacovigilance organisée par le TRT-5, le 16 mars dernier, a confirmé ce que nous savons depuis plusieurs années : l’absence d’essais de Phase IV est préjudiciable aux malades du sida.
-
 Édito
Édito
L’urgence imposée par la pandémie du sida a profondément modifié la recherche médicale. A la fin des années 80, alors qu’étaient expérimentées les premières molécules potentiellement actives contre le virus, les personnes vivant avec le VIH comprirent rapidement que de participer à ces recherches constituait pour elles le seul moyen d’accéder plus rapidement aux traitements qui augmenteraient leur chance de survie. Il a fallu se battre pour faire évoluer les procédures institutionnelles et les mentalités des chercheurs qui n’envisageaient pas un accès précoce aussi massif aux produits expérimentés. Si cette mobilisation des séropositifs a été un formidable accélérateur de la recherche, elle a aussi constitué une aubaine pour les industriels du médicament. Dans ce contexte, l’information aux personnes n’était pas une priorité, leur consentement était acquis d’avance, les résultats étaient partagés au jour le jour comme des informations vitales.
-
 La recherche et l’information
La recherche et l’information
1er mars 2010
Nous disposons aujourd’hui, via les médias et l’informatique, d’un nombre important de sources d’information concernant la recherche clinique dans presque tous les domaines. Cet état de fait n’a pas toujours existé.
-
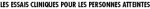 le consentement éclairé
le consentement éclairé
16 août 1997
Quelles questions dois-je me poser ?
 Act Up-Paris
Act Up-Paris