Accueil > Mots-clés > sida, un glossaire P > prophylaxie
prophylaxie
Ensemble des moyens destinés à prévenir l’apparition, la propagation ou l’aggravation d’une maladie, à l’aide de dépistage, de médicaments, de messages de prévention, c’est le cas, par exemple, du paludisme.
Une prophylaxie médicamenteuse primaire est utilisée pour prévenir une première manifestation infectieuse, une prophylaxie secondaire pour éviter une rechute.
Dans le cas du VIH, une prophylaxie, ou traitement d’urgence (TPE), est composé le plus souvent d’une combinaison de 3 antirétroviraux ; il peut être prescrit à toute personne qui a été exposée à un risque de contamination par le VIH, et ce, pour une durée de 4 semaines. Ce risque concerne également le personnel de santé en cas de blessure par matériel médical, et tous et toutes en cas de viol, de rupture de préservatif, de partage de seringues, etc. Le traitement doit intervenir dans les 48 heures qui suivent l’événement. Il sera encore plus efficace s’il est administré dans les 4 heures qui suivent la prise de risque.
Voir prévention
Articles
-
 Edito
Edito
Le préservatif demeure le seul moyen efficace de se protéger du sida. En cas de rapport non protégé, de rupture de préservatif, ou de toute autre prise de risque, on peut en France grâce à l’action des associations bénéficier d’un traitement Prophylactique post-exposition (TPE).
-
 Act Up-Paris dénonce le coup médiatique de Bernard Kouchner
Act Up-Paris dénonce le coup médiatique de Bernard Kouchner
29 juillet 1997
Le 24 juin dernier, Act Up-Paris dénonçait publiquement l’inégalité d’accès au traitement prophylactique après une exposition au VIH.
-
 Traitements d’urgence : 4 heures pour réagir
Traitements d’urgence : 4 heures pour réagir
5 juillet 2003
Le dispositif d’accès aux traitements d’urgence pour les personnes séronégatives exposées au VIH a été publié en avril 2003.
-
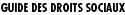 Le traitement d’urgence : pour qui ? Quand ?
Le traitement d’urgence : pour qui ? Quand ?
1er avril 2010
Le traitement doit commencer le plus tôt possible, dans l’idéal avant la 4e heure suivant l’exposition et dans la limite maximum de 48 heures.
-
 prophylaxies post exposition
prophylaxies post exposition
20 mai 2002
Jusqu’à maintenant, si vous êtes séronégatif et que vous pensez avoir été exposé au VIH, vous pouvez vous rendre dès que possible, et sous 48 heures au maximum après la prise de risque, au service d’urgence de n’importe quel hôpital pour y recevoir un traitement préventif.
-
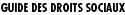 Traitement d’urgence en cas d’exposition au VIH
Traitement d’urgence en cas d’exposition au VIH
30 avril 2003
En cas de risques de contamination par le VIH (rapport non protégé, préservatif ayant craqué), vous devez vous rendre dans les plus brefs délais aux services des urgences pour y recevoir un traitement prophylactique après votre exposition au risque de contamination.
-
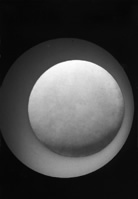 l’hôpital va mal et nous aussi
l’hôpital va mal et nous aussi
27 novembre 2001
Le 4 octobre dernier, nous étions une vingtaine à participer à une table ronde consacrée aux problèmes des hôpitaux. Les problèmes d’accueil des malades dans les hôpitaux se multiplient, que ce soit dans les services VIH ou dans des services spécialisés (diététique, hépato, chirurgie, etc.).
-
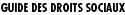 Le respect de l’intégrité physique : viol et maltraitance
Le respect de l’intégrité physique : viol et maltraitance
1er avril 2010
Nous avons reçu plusieurs témoignages de viol ou maltraitance de la part de codétenus ou de surveillants. En dehors de la responsabilité des personnes qui ont commis des violences, viols ou maltraitances, l’Administration Pénitentiaire engage sa responsabilité si elle reste passive face à de tels agissements et ne vous protège pas.
L’Administration Pénitentiaire doit « assurer le respect de la dignité inhérente à toute personne qui lui est confiée par l’autorité judiciaire » (Article D.189 (…)
-
 Contre-argumentaire (suite)
Contre-argumentaire (suite)
15 mai 2004
Ce second contre-argumentaire, moins pédé-centré nous permet de répondre plus largement aux mauvaises excuses qui légitiment les prises de risques sexuels.
-
 Prévention
Prévention
Eté 1997, Act Up-Paris entame et gagne un redoutable bras de fer contre les pouvoirs publics, pour l’application immédiate de la note 666 du 28 octobre 1996, à savoir la mise à disposition des traitements post-exposition pour tous et pas seulement pour les accidents professionnels du corps médical.
 Act Up-Paris
Act Up-Paris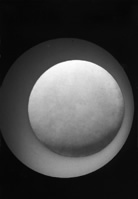 l’hôpital va mal et nous aussi
l’hôpital va mal et nous aussi