Même en détention, le secret médical s’impose à toute personne intervenant dans votre suivi médical. En réalité, ce secret n’est pas respecté, en particulier lorsque l’accès aux dossiers médicaux est rendu possible au personnel de surveillance, ou que ce dernier ou certainEs prisonnièrEs participent à la distribution des médicaments.
Accueil > Mots-clés > Guide des droits sociaux > droits et détention
droits et détention
Articles
-
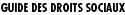 Le secret médical et l’accès aux soins et aux traitements
Le secret médical et l’accès aux soins et aux traitements
1er avril 2010 -
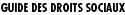 L’Allocation Temporaire d’Attente (ATA)
L’Allocation Temporaire d’Attente (ATA)
1er avril 2010Créée par la loi de finances 2006, elle s’adresse aux sortantEs de prison ayant purgé une peine d’au moins 2 mois, aux apatrides et aux demandeurSEs d’asile ainsi qu’aux bénéficiaires de certaines prestations. Elle est soumise à l’impôt, mais pas à la CSG ni à la RDS.
-
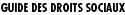 Les organes de contrôle
Les organes de contrôle
1er avril 2010Attention ! Certains courriers ne peuvent être ouverts, notamment ceux adressés aux autorités administratives et judiciaires françaises (magistratEs, avocatEs, sénateurs/trices, maires, etc.), aux médecins inspecteurs/trices des DRASS, aux médecins de la DDASS et au/à ma chefFE de l’IGAS. Ces courriers doivent être envoyés sous pli fermé. La qualité du/de la destinataire doit être clairement indiquée.
L’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS)
En cas de difficultés rencontrées (...) -
 Liberté d’expression pour les personnes détenues
Liberté d’expression pour les personnes détenues
25 octobre 2002Qu’on se le dise : la prison est un lieu de non-droit. À Marseille, Yves Peyrat l’a appris à ses dépens. Condamné pour avoir tenté de plastiquer des locaux du FN, il se retrouve placé depuis le 1er octobre en quartier d’isolement pour avoir diffusé un tract demandant la libération de tous les détenus malades.
-
 Les prisonniers, c’est toujours du fric pour SODEXHO
Les prisonniers, c’est toujours du fric pour SODEXHO
20 juin 2001Une cinquantaine de militants ont investi l’embarcadère des Bateaux Parisiens (Paris), filiale de la Sodexho, pour protester contre l’exploitation par celle-ci des détenus en France et partout dans le monde.
-
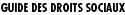 Droit aux allocations
Droit aux allocations
1er avril 2010Les allocations chômage
Du fait de votre incarcération, vous n’êtes plus considéréE comme demandeurSE d’emploi. Si vous étiez inscritE au Pôle Emploi, vous êtes radiéE le jour de votre entrée en prison et vous ne touchez plus vos allocations chômage. Vous devez prévenir le Pôle Emploi de votre changement de situation, par écrit, lors de votre déclaration mensuelle de situation, sans quoi vous devrez rembourser les sommes touchées « indûment ».
La commission Droits Sociaux d’Act (...) -
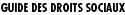 Le travail
Le travail
30 juillet 2003Depuis 1987, le travail n’est plus obligatoire en prison. Par contre, l’article 720 du CPP indique que l’Administration pénitentiaire est obligée de procurer aux détenus qui le veulent les moyens pour une activité professionnelle.
-
 Travail en prison = esclavage légal
Travail en prison = esclavage légal
Nous avions défilé le matin dans le cortège général de la CNT, avec le Leonard Peletier Support Group, l’Observatoire du Droit des Usagers et Ras les Murs, sous la banderole « Travail en prison, esclavage légal » pour exiger l’application immédiate et sans conditions du droit du travail en détention.
-
 Les prisonniers, c’est du fric pour SODEXHO
Les prisonniers, c’est du fric pour SODEXHO
4 avril 2001Aujourd’hui, une trentaine de militants se sont rendus devant un site de la SODEXHO à proximité de la Bourse, afin de dénoncer l’exploitation des détenus par cette entreprise.
-
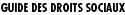 Usages de drogues et substitution
Usages de drogues et substitution
1er avril 2010Voir la partie consacrée à La substitution aux opiacés
 Act Up-Paris
Act Up-Paris